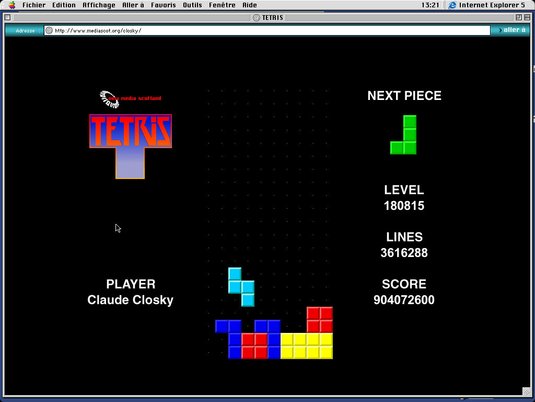Pierre Bismuth, le grand détournement
L'exposition Pierre Bismuth s’ouvre sur un titre en forme de paradoxe, détournant une phrase célèbre de l’artiste allemand Joseph Beuys (« Chaque être humain est artiste. »). Mêlant des œuvres emblématiques de l’artiste à d’autres spécialement conçues pour l’occasion, elle offre une approche inédite de son travail, sans doute entreprise artistique des plus singulières de la scène contemporaine. Car Pierre Bismuth ne cantonne sa pratique à aucun domaine artistique en particulier, utilisant volontiers des extraits de films, des œuvres d’autres artistes ou des images trouvées. Seul artiste français à avoir été distingué par un Oscar à Hollywood, décerné conjointement en 2005 à Bismuth, Michel Gondry et Charlie Kaufman pour le scénario de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Pierre Bismuth, fait, malgré diverses stratégies de détournement, du cinéma un élément essentiel de son œuvre. Dialogue entre l'artiste et Jean-Pierre Criqui, commissaire de l'exposition.
Jean-Pierre Criqui — Commençons par le commencement, autrement dit le titre de votre exposition : « Tout le monde est artiste mais seul l’artiste le sait ». Ces mots reprennent et complètent, ou précisent, d’une certaine manière, un propos bien connu de Joseph Beuys, dont on célèbre en cette année 2021 le centenaire de la naissance : « Tout le monde est artiste » (« Jeder Mensch ist ein Künstler », ndlr). Vous sentez-vous une quelconque affinité avec Beuys, et comment faut-il comprendre la reformulation que tu nous proposes de sa phrase ?
Pierre Bismuth — L’énoncé de Beuys était une critique à l’égard de Marcel Duchamp : si toute chose produite par l’homme peut devenir de l’art, alors Duchamp aurait dû être amené à démystifier l’artiste, au lieu de lui laisser comme il l’a fait le privilège et le bénéfice de cette opération « spéculative ». Duchamp serait en quelque sorte la figure du capitaliste par excellence, créant de la valeur sur le travail d’autrui. Le raisonnement de Beuys me semble très juste, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’il faut être artiste pour en avoir conscience. Ne serait-ce que parce que l’artiste est mieux placé que quiconque pour savoir qu’il n’y a effectivement rien chez lui qui le distingue de n’importe quel autre individu. Quand j’ai écrit cet aphorisme en 1992, j’étais très intéressé par l’idée de montrer la manière dont nous sommes tous engagés dans des processus créatifs, souvent même à l’occasion d’opérations complètement insignifiantes. Ce qui distingue l’artiste aujourd’hui, ce serait donc sa volonté d’être artiste et c’est ce qui peut l’amener à placer dans le champ de l’art une série d’opérations pouvant être par ailleurs engagées par n’importe qui.
Ce qui distingue l’artiste aujourd’hui, ce serait donc sa volonté d’être artiste et c’est ce qui peut l’amener à placer dans le champ de l’art une série d’opérations pouvant être par ailleurs engagées par n’importe qui.
Pierre Bismuth
Cette volonté d’être artiste, vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles vous l’avez pour la première fois clairement éprouvée, à quel moment de votre vie, et avec quelles conséquences immédiates, s’il y en a eu ?
Il y a eu différents stades. Mon éducation bourgeoise et un certain don pour le dessin et la peinture ont fait qu’adolescent j’aimais l’idée de pouvoir faire de l’art, et cette perspective était bien accueillie par mes parents. D’ailleurs mon père aurait lui-même aimé être réalisateur de cinéma, mais son père voulait qu’il soit médecin. Au moment de mes études supérieures, vers 1980, ayant été à la fois reçu aux beaux-arts de Paris et aux Arts décoratifs et ne sachant pas quoi choisir, j’ai suivi les deux formations pendant plusieurs mois. Sans doute faute de ne pas avoir été encadré par les bonnes personnes aux beaux-arts et d’avoir au contraire étudié avec des gens intéressants aux Arts déco, j’ai finalement trouvé le graphisme et la communication plus stimulants. Un des tout premiers exercices qui m’a fait prendre conscience de l’intérêt des Arts déco a été le jour où on nous a demandé de dessiner très schématiquement, de mémoire, la structure d’un vélo. Je crois que personne n’a réussi et cela m’avait semblé particulièrement intéressant de constater notre incapacité à comprendre ou à enregistrer une forme à laquelle on avait pourtant été confrontés depuis l’enfance.
En 1983, alors que j’étais encore aux Arts déco tout en étant déjà engagé dans la vie professionnelle en tant que graphiste. J’étais par exemple maquettiste pour le magazine Actuel, ce qui m’a permis de côtoyer un peu Jean-François Bizot, l’un des fondateurs du magazine.
Pierre Bismuth
Puis en 1983, alors que j’étais encore aux Arts déco tout en étant déjà engagé dans la vie professionnelle en tant que graphiste. J’étais par exemple maquettiste pour le magazine Actuel, ce qui m’a permis de côtoyer un peu Jean-François Bizot, l’un des fondateurs du magazine. Je suis parti à Berlin, à la Hochschule der Künste, avec une bourse d’étude, et là j’ai commencé à discuter et à lire au sujet de pratiques artistiques plus contemporaines que ce à quoi j’avais été confronté jusqu’ici. C’est d’ailleurs là que j’ai découvert Beuys. Finalement, revenu en France vers 1985, j’ai décidé de faire de l’art. C’est aussi à ce moment-là que, avec Xavier Veilhan et Pierre Huyghe, eux aussi des Arts déco, nous avons décidé de nous réunir et de parfaire ensemble notre éducation artistique. Les conséquences ont été pour moi dix ans de grand flou durant lesquels je ressentais très fortement l’absence de base académique solide.
La peinture était-elle encore importante pour vous au moment de votre retour ? La scène artistique berlinoise du début des années 1980 faisait une large place à la peinture et vous avez étudié un temps avec Georg Baselitz à ce moment-là...
Pour être tout à fait précis, j’avais suivi Xavier Veilhan qui avait eu la même bourse un an plus tôt et était dans les ateliers de Baselitz. J’y avais donc obtenu une place, mais mon professeur était Karl Horst Hödicke, un autre peintre des Neue Wilde (Nouveaux fauves, ndlr), avec notamment Baselitz, Markus Lüpertz et A.R. Penck. Et puis il y avait aussi à Berlin, dans cette mouvance, des peintres plus jeunes et très à la mode tels que Salomé, Rainer Fetting ou Helmut Middendorf. Avant d’arriver à Berlin, j’avais été très impressionné par une grande peinture de Baselitz que j’avais vue au Centre Pompidou, mais une fois sur place, en côtoyant ses étudiants, je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout mon univers. En revanche à Cologne il y avait Jiří Georg Dokoupil et Walter Dahn, et à Düsseldorf Jörg Immendorff, Martin Kippenberger et Albert Oehlen qui me semblaient plus ludiques. Je ne sais même pas si on peut dire que la peinture était importante pour moi. C’est plutôt que je ne savais pas que l’art pouvait être complètement autre chose.
Avant d’arriver à Berlin, j’avais été très impressionné par une grande peinture de Baselitz que j’avais vue au Centre Pompidou, mais une fois sur place, en côtoyant ses étudiants, je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout mon univers.
Pierre Bismuth
Quoi qu’il en soit, même si à Berlin la peinture était très à la mode, j’ai malgré tout été exposé à beaucoup d’autres choses qui m’ont ouvert l’esprit. À mon retour de Berlin la peinture n’était certainement plus pour moi l’unique manière de penser l’art. Cela dit, même si j’ai pris conscience qu’un artiste pouvait exister en racontant l’art à un lièvre mort ou bien en transformant une galerie d’art en écurie, ou encore en creusant des tranchées dans le Nevada, ça n’implique pas pour autant qu’on puisse le faire soi-même. C’est comme de voir un vêtement qui vous plaît sur quelqu’un d’autre, mais qu’on ne se sent absolument pas capable de porter.
Comment était l’ambiance à Paris, et, indépendamment des lacunes en matière académique, à quoi était dû selon vous ce flou que vous dites avoir alors traversé ?
Le flou dont je parle, et qui je crois est ressenti en général par les jeunes artistes, vient simplement du fait que le désir de faire de l’art précède de beaucoup la compréhension de ce qu’on doit faire, que l’on balance entre l’adhésion à des formes et à des positions qui existent déjà et des choses qui nous concernent personnellement, mais qui ne se trouvent pas nécessairement dans le champ de l’art et peuvent n’avoir encore aucune résolution formelle. Il me semble que le flou disparaît naturellement avec le temps, lorsque la question de savoir si ce qu’on fait est de l’art n’a plus aucune importance. Pour moi un voile s’est aussi levé lorsque j’ai découvert l’art conceptuel et tout ce qui lui était de près ou de loin associé. Je me rappelle très précisément que j’avais alors décidé de passer outre les années 1980 et d’ouvrir le moins possible le magazine Flash Art, afin de revenir sur les années 1970 qui me semblaient mieux correspondre à mes préoccupations. Cela avait aussi déjà été engagé à Berlin par la rencontre avec deux artistes français de passage pour une exposition de groupe, Bernard Bazile et Jean-Marc Bustamante, qui travaillaient alors ensemble. Nous avions passé de longues soirées à discuter et nous avons continué à fréquenter un moment Bazile à Paris. Par lui nous avons rencontré Frédéric Migayrou (conservateur au Centre Pomidou, ndlr), qui a ensuite écrit pour le catalogue d’une exposition avec Xavier et Pierre, puis un autre texte pour mon premier catalogue personnel. Ces rencontres ont été très riches et déterminantes, elles ont bouleversé nos conceptions. Après cela il y en a eu d’autres : Nicolas Bourriaud, Hans-Ulrich Obrist, ou plus tard Warren Niesłuchowski.
C’était une période très excitante pour moi, tout était possible. Et puis c’était les années Mitterrand, avec Jack Lang : il y avait encore une sorte d’euphorie parmi les gens que je fréquentais. La culture paraissait au premier plan. Mais il faut avouer quand même que c’est en quittant la France vers 1992 que j’ai pu vraiment me développer. Un moment déterminant a été une exposition de groupe au Witte de With, à Rotterdam, en 1995, avec comme commissaires Chris Dercon et Gosse Oosterhof. Je me suis alors lié d’amitié avec des artistes de la scène de Glasgow et avec des artistes anglais. À partir de là, grâce aux expositions de groupe, il y a eu beaucoup de rencontres importantes et déterminantes avec d’autres artistes.
Parallèlement à votre intérêt pour l’art conceptuel et à la réinterprétation, assez dadaïste, pourrait-on dire, que vous en avez faite, c’est la prise en compte du cinéma qui vous a fait accéder à une forme de maturité artistique. Que diriez-vous à ce sujet ?
Honnêtement, je ne sais pas. Il est possible que vous voyiez une forme de maturité artistique dans une partie de mon travail plutôt que dans telle autre, mais personnellement j’en serais bien incapable. Peut-être faut-il commencer par rappeler la manière dont la relation au cinéma s’est faite. Vers la fin des années 1980, j’avais le sentiment que dès que je voulais créer quelque chose, je ne savais plus quoi faire, alors que dès que je pensais à autre chose j’étais immédiatement engagé dans nombre d’activités intéressantes. J’ai donc fini par chercher à capturer certains de ces moments où l’on crée des choses sans s’en rendre compte. Un des moyens que j’avais trouvés était d’enregistrer le moment où l’on choisit des synonymes dans le thésaurus de l’ordinateur lorsqu’on écrit un texte (What, 1994 ; Beyond, 1994 ; What Beyond, 1995). C’était pour moi comme le degré zéro de la création : chercher une chose pour une autre. Par extension je me suis intéressé à l’activité de retranscription. J’avais alors l’idée de demander à une dactylo de retranscrire une information sonore, comme avec Post-Script (1996), et plus tard The Party (1997). C’est uniquement parce que je cherchais une source sonore suffisamment dynamique que j’ai utilisé la bande-son d’un film, mais je me moquais royalement du film. Et patatras, je me retrouve embarqué avec tous les artistes qui s’intéressent au cinéma : Eija-Liisa Ahtila, Fiona Banner, Stan Douglas, Pierre Huyghe, Christoph Draeger, Douglas Gordon, Steve McQueen, Joachim Koester, Mark Lewis, Sharon Lockhart, Matthias Müller, Christoph Girardet, Candice Breitz, Omer Fast, Christian Marclay, etc.
Au moment où j’avais finalement bien déployé mon travail en dehors de la question du cinéma..., je reçois un Oscar à Hollywood ! Là j’ai effectivement abandonné toute tentative de mise au point.
Pierre Bismuth
C’est ce qui m’a donné de la visibilité et j’en ai été très heureux, mais durant les années qui ont suivi j’ai clamé autant que possible que mon travail n’était pas particulièrement sur le cinéma. Au moment où j’avais finalement bien déployé mon travail en dehors de la question du cinéma..., je reçois un Oscar à Hollywood ! Là j’ai effectivement abandonné toute tentative de mise au point, et c’est peut-être cette capitulation face au cinéma qui marque selon vous l’accès à une certaine maturité artistique.
Par « maturité » je faisais allusion à cette sortie du « flou » que vous avez évoqué, mais je me rends compte que le terme est pour le moins ambigu dans la mesure où une sorte d’« immaturité » peut se voir tout aussi bien revendiquée pour une œuvre comme la vôtre (on trouve dans les livres de Witold Gombrowicz, par exemple dans son roman Ferdydurke, paru en 1937, un plaidoyer en faveur de l’immaturité en tant que reste irréductible d’enfance, notamment en art). « Mûrir, c’est pourrir un peu », comme a sans doute déjà dit quelqu’un, et cela ne constitue pas une perspective bien exaltante.
C’est très juste. Mais qu’entendez-vous exactement par « réinterprétation dadaïste de l’art conceptuel » ?
Je veux dire que les procédures que vous y trouvez sont souvent mises au service d’un sens très poussé de l’absurde, du burlesque : d’une volonté de « dégonflage » où persiste un goût du jeu commun aux enfants et aux artistes dada ou néodada.
Oui. J’aime beaucoup le terme de « dégonflage », je m’y reconnais complètement. C’est aussi une vaste opération de neutralisation du sens. Ce qui du reste n’est pas vraiment la tendance actuelle. Les artistes aujourd’hui traitent plutôt de manière littérale des sujets de société et le revendiquent. À ce sujet, à l’occasion de l’exposition de Francis Bacon au Centre Pompidou, la lecture de ses interviews m’a permis de me souvenir qu’il n’y a pas si longtemps, en 1992, un artiste pouvait encore soutenir ne pas pouvoir et ne pas avoir à expliquer son œuvre. Cela semble impensable aujourd’hui. Mais pour revenir à l’immaturité dont tu parlais, c’est probablement aussi une cause ou une conséquence du fait que je me retrouve volontiers dans des domaines que je ne maîtrise pas vraiment. L’expérience m’a montré que ce qui se présente à moi est souvent mieux que ce dont je pouvais rêver. Donc j’aime bien que la contingence détermine mes choix. Et c’est précisément comme cela que je me suis retrouvé à faire du cinéma. Michel Gondry m’avait demandé un jour d’écrire un petit synopsis et je l’ai fait. Après l’Oscar en 2005, on m’a demandé si je n’avais pas un projet de long-métrage : j’ai proposé un vague projet et je me suis ensuite engagé à le réaliser (Where Is Rocky II?, 2016, ndlr).
À l’occasion de l’exposition de Francis Bacon au Centre Pompidou, la lecture de ses interviews m’a permis de me souvenir qu’il n’y a pas si longtemps, en 1992, un artiste pouvait encore soutenir ne pas pouvoir et ne pas avoir à expliquer son œuvre. Cela semble impensable aujourd’hui.
Pierre Bismuth
Il me semble en effet que, du moins dans un premier temps, vous n’avez pas travaillé sur le cinéma, mais avec lui, comme avec un matériau dont la nature vous était largement indifférente (je pense à votre invention d’un genre de « dessin trouvé » en suivant la main d’une actrice dans un film ou d’une personnalité dans un document filmé). Mais votre rapport au cinéma est complexe... Mettons de côté l’Oscar, puisque vous avez par la suite réalisé Where Is Rocky II?, et que vous avez un autre long-métrage actuellement en chantier. Pourriez-vous revenir sur ces présences très diverses du cinéma dans votre travail ?
À nouveau, c’est le hasard de ma rencontre avec Jean-Claude Carrière qui a fait que je me suis retrouvé à travailler avec lui sur l’adaptation d’un scénario qu’il avait écrit avec Luis Buñuel en 1976, scénario adapté de Là-Bas, un roman de Joris-Karl Huysmans cher à Buñuel depuis longtemps, mais qui pour des raisons diverses n’est pas allé plus loin que le script. Il faut à ce stade préciser un aspect de ma méthode de travail qui est révélateur de ce que j’attends de la pratique artistique, que ce soit dans l’art ou dans le cinéma. Comme je l’ai dit, les projets arrivent plutôt de manière contingente, mais une fois qu’un projet est engagé, je ne questionne plus son bien-fondé. Je deviens une machine qui exécute, mon principe étant essentiellement de me retrouver, presque malgré moi, engagé dans une activité. Cela constitue à la fois la méthode et la structure même des œuvres.
Une fois qu’un projet est engagé, je ne questionne plus son bien-fondé. Je deviens une machine qui exécute, mon principe étant essentiellement de me retrouver, presque malgré moi, engagé dans une activité. Cela constitue à la fois la méthode et la structure même des œuvres.
Pierre Bismuth
Dans En suivant la main droite de… le sens et le contenu des films sont totalement éludés : les longs-métrages sont juste utilisés comme des machines à dessiner. Dans Where Is Rocky II? , l’artiste Ed Ruscha n’est en réalité qu’un prétexte à produire de l’action. C’est une constante de mon travail : l’action vient avant le sens. Il ne faut pas chercher quel est le sens de la vie, mais simplement apprécier la manière dont la vie crée du sens. Et c’est pour cela que j’aime ne pas avoir à choisir le sujet ou l’objet de mon travail.
L’existence précède le sens, en somme.
En tout cas le choix de l’objet ou du sujet devient secondaire, parce que c’est ce que j’en fais qui est déterminant et cela amène souvent à des détournements pratiques, comme on utiliserait une porte pour faire une table. C’est pour cela que je pars essentiellement de productions déjà existantes. Il y a suffisamment de choses signifiantes comme ça, et plutôt que d’en rajouter il faut surtout en éliminer, ou recycler ce qui existe déjà.
C’est une constante de mon travail : l’action vient avant le sens. Il ne faut pas chercher quel est le sens de la vie, mais simplement apprécier la manière dont la vie crée du sens. Et c’est pour cela que j’aime ne pas avoir à choisir le sujet ou l’objet de mon travail.
Pierre Bismuth
Les exemples les plus évidents, ce sont les Origamis dépliés (2003-2004), des images imprimées mais utilisées comme du simple papier, ou encore les Newspapers (2000-2001) dans lesquels les images des « unes » sont dédoublées. Ou encore la nouvelle série Variations sur le thème des nations (2019-2021), dans laquelle les motifs de drapeaux nationaux sont utilisés pour produire des combinaisons « picturales ». Tout cela sans que ne soit jamais indiqué comment interpréter la superposition de deux symboles nationaux. Tous ces mésemplois renvoient aussi à ce que tu disais sur le jeu des enfants. Mon fils, par exemple, joue essentiellement depuis un an avec mon parapluie. Il prétend que c’est un fusil. Il a des jouets, mais il préfère utiliser le parapluie. Donc il y a vraisemblablement en nous un plaisir ou même un besoin profond du détournement. Mais le détournement ne me semble intéressant que s’il est induit par un usage, et seulement s’il ne découle pas d’un pur jeu d’esprit, ce que j’exècre.
J’aimerais que l’on conclue en évoquant le thème alimentaire qui apparaît çà et là dans votre travail. Vos tout premiers tableaux en 1986 et 1987 reprenaient des fiches cuisine de magazines. On peut mentionner aussi Confiture d’artiste et Magazine Piece en 2011, et ces blocs de plastique au goût de poulet frit en 2015. Et le Double vitrage au jus d’orange pour la présente exposition.
J’aime beaucoup cuisiner, mais je ne suis pas spécialement gourmand. On m’a d’ailleurs fait remarquer que je ne dis pas d’un plat qu’il est bon ou mauvais, mais qu’il est intéressant ou pas. Dans la liste des œuvres, il faudrait aussi rajouter une performance en 2010 au Musée d’art et d’histoire du judaïsme de Paris, Le Psy, l’artiste et le cuisinier, où je me retrouvais en public sur le divan d’un psychanalyste lacanien pour parler de mon travail pendant qu’une cuisinière juive tunisienne préparait des plats traditionnels.
Je me souviens également que vous avez détourné en 2008 la performance de Andy Warhol mangeant un hamburger. Et Il y a aussi le Chocolat Pierre Bismuth, lancé en 2019...
Si j’ai rejoué Warhol mangeant un hamburger, c’est parce que j’étais invité à un symposium au MUDAM (Musée d’art contemporain du Luxembourg, ndlr) pour parler de la question de l’appropriation dans mon travail et que mon intervention tombait précisément à l’heure du déjeuner. Le Chocolat Pierre Bismuth a été quant à lui élaboré afin de satisfaire mon envie d’un chocolat que je n’arrivais pas à trouver dans le commerce, à savoir un chocolat au lait de qualité supérieure très peu sucré. Cela m’amusait bien sûr de mettre mon nom sur un produit de consommation courante. Les artistes sont depuis longtemps à la fois critiques à l’égard de la production industrielle et fascinés par elle, ils l’ont mimée ou parodiée, ils y participent parfois, mais je ne connais pas d’artiste ayant créé un produit commercial, comme l’acteur américain Paul Newman a lancé sous son nom une marque de vinaigrette et de sauce tomate. Le dessinateur de BD underground Robert Crumb a quand fait quelque chose de très proche en créant le packaging d’une barre de chocolat industrielle, « Devil Girl ». Mais c’était plutôt un travail sur l’image et une dénonciation ironique du système industriel et commercial. Pour ma part, je tente vraiment de m’insérer dans la chaîne de production en intervenant sur le goût même. J’ai d’ailleurs tout fait pour le moment pour avoir l’image la plus standard possible. L’œuvre ici, c’est vraiment le goût.
L’art étant devenu un « loisir culturel », le spectateur se retrouve cantonné dans un rôle de consommateur, à l’écart de toute impulsion créative, ou même de toute prise de conscience de ce qui est créatif dans nos actions quotidiennes les plus insignifiantes.
Pierre Bismuth
Faudrait-il voir dans votre intérêt pour le thème alimentaire une sorte de revendication matérialiste : un effet ou une conséquence de l’esthétique qui me semble être la vôtre, à l’écart du « spirituel », de la « transcendance » et d’autres fables ?
La cuisine m’apparaît plutôt comme un type d’activité quotidienne de plus en plus absent dans les pratiques artistiques actuelles. Un artiste comme moi n’a effectivement pas de discipline artistique qui lui permette d’accéder à cet état d’absorption, de concentration, selon moi capital et très spécifique aux activités purement pratiques. Dans ce sens, j’ai opéré une sorte de transfert de la pratique d’atelier à l’activité de la cuisine et j’y trouve indiscutablement une dimension spirituelle. De manière générale, nous sommes émancipés des activités les plus basiques qui faisaient autrefois notre existence. En dehors du travail, le reste de nos activités est de l’ordre des loisirs : ateliers de jardinage, de bricolage, vélo, gymnastique, yoga, musique, art… Autant de condiments dans une existence désœuvrée. L’art étant devenu un « loisir culturel », le spectateur se retrouve cantonné dans un rôle de consommateur, à l’écart de toute impulsion créative, ou même de toute prise de conscience de ce qui est créatif dans nos actions quotidiennes les plus insignifiantes. C’est peut-être ça finalement l’idée du Chocolat Pierre Bismuth : si le public de l’art ne peut échapper au rôle de consommateur, alors autant qu’il mange du bon chocolat ! ◼