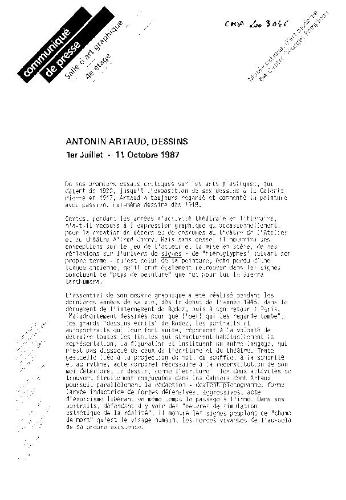Exhibition / Museum
Antonin Artaud, Dessins

The event is over


Cette exposition est consacrée aux dessins d’Antonin Artaud (1896-1948).
Révélée dans toute son ampleur par la publication de Paule Thévenin et Jacques Derrida, l’ensemble de l’œuvre graphique d’Antonin Artaud est, trente ans après l’exposition de la Galerie Pierre, enfin réunie au Musée national d’art moderne : plus d’une soixantaine de dessins au total (depuis les premiers Sorts de 1939, missives calligraphiées, dessinées et brulées, jusqu’aux derniers grands dessins de 1948, plus complexes) dont près de la moitié, ainsi que des Cahiers et des lettres, sortent pour la première fois de chez les collectionneurs.
Artaud a toujours regardé et commenté la peinture avec passion. Lui-même dessina dés 1918. L’essentiel de son œuvre graphique a été réalisée pendant les dernières années de sa vie, dès le début de l’année 1945, dans le dénuement de l’internement de Rodez, puis à son retour à Paris.
« Maladroitement dessinés pour que l’œil qui les regarde tombe », ces grands dessins […] se dérobent à toute définition, répondent, à la suite des Sorts dessinés et brûlés de 1939-42, à la volonté de détruire toutes les limites qui structurent habituellement la représentation, la figuration. Véritable acte de précipitation, de perforation, opéré à l’encontre de ce qu’Artaud a nommé le « subjectile » (le support) pour libérer le passage à l’inné, à l’intraduisible, le graphisme d’Artaud institue un autre langage qui suscite, aujourd’hui peut-être plus que jamais, tous les questionnements sur la fonction du dessin.
Trace d’un geste lancé « sur la page comme un mépris des formes et des traits afin de mépriser l’idée prise et d’arriver à la faire tomber », il est pictogramme actif, motif inducteur de forces, acte d’exorcisme, « gris-gris » suivant la propre appellation d’Artaud.
Inséparable de l’écriture : […] Artaud dira que ce sont des « dessins écrits » […]. Inséparable tout autant du théâtre : par cette « machine qui a du souffle », expulsant en même temps mots, gestes, sonorités, rythmes, des emblèmes graphiques – traces retrouvées d’un langage perdu – sont projetés dans l’espace […].
[ …] De même, dans ses Portraits et Autoportraits du retour à Paris, Artaud n’aura de cesse, avec une lucide cruauté, de re-produire la présence du visage humain, « tout ce qui reste de la revendication, de la revendication révolutionnaire d’un corps qui n’est pas et ne fut jamais conforme à ce visage », d’interroger les signes inscrits de sa secrète histoire, d’y parcourir, d’une façon toujours conjuratoire, ce champ de mort qu’est l’espace de la figure. Dans ces derniers grands dessins, plus complexes, il en arrive, par l’accumulation, la superposition, l’emboîtement des visages dessinés, comme dans le théâtre par le rassemblement de syllabes et de membres éclatés, à ériger des sortes de fétiches humains, des « espèces de contre-figures », de contre-corps qui seraient aussi une « protestation perpétuelle contre la loi de l’objet créé ». […]
D’après Agnès de La Beaumelle, CNAC magazine, n°40, 15 juillet-15 septembre 1987, et le communiqué de presse
When
every days except tuesdays