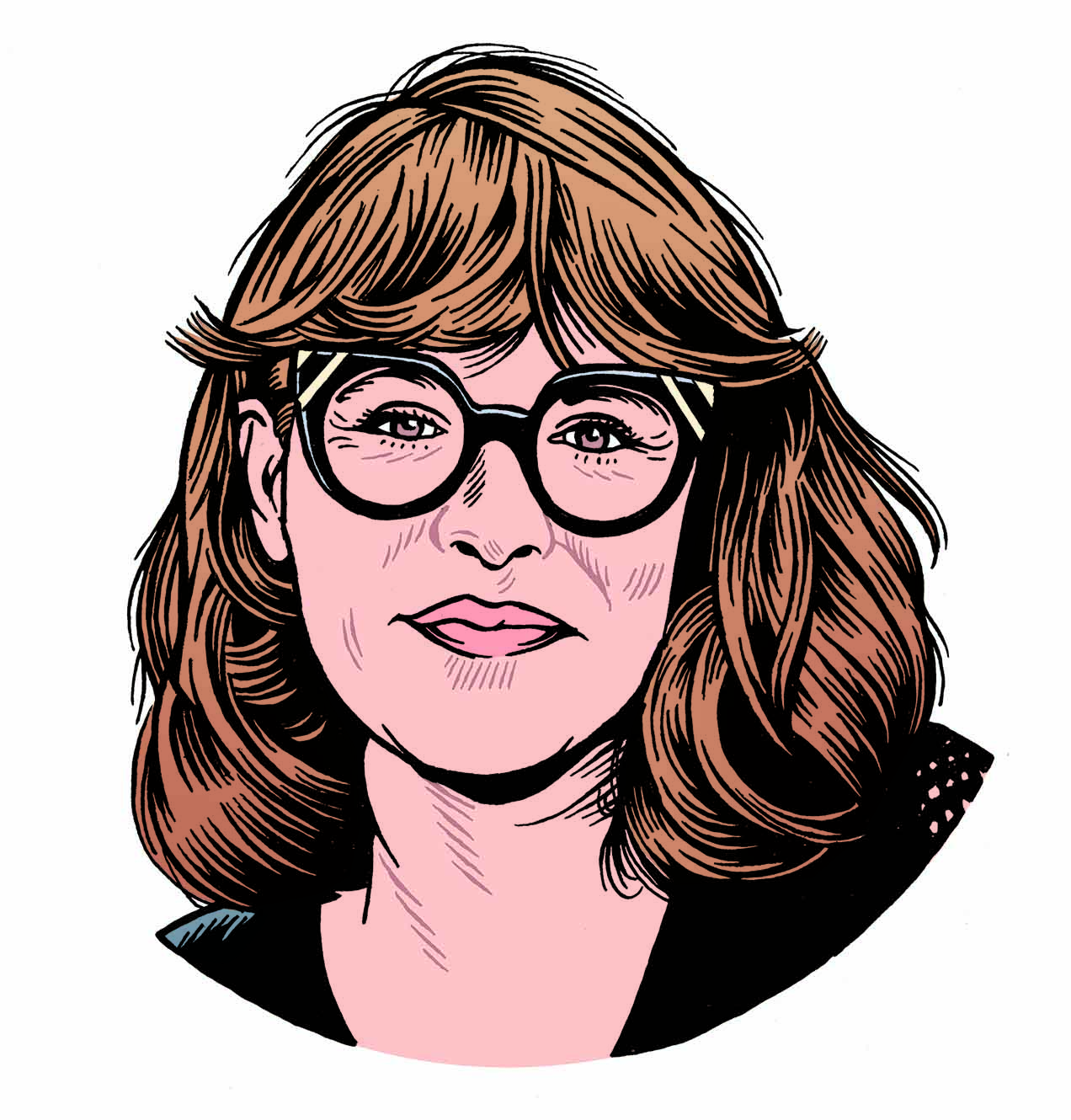Chez André Breton, au 42 rue Fontaine, Paris
« J’habite depuis deux mois place Blanche. [….]
Je ne me souviens pas d’avoir vécu ailleurs ;
ceux qui disent m’avoir connu doivent se tromper ».
André Breton, « Lâchez tout », in Les Pas perdus (1924)
Les visiteurs d’André Breton qui franchissaient le seuil du 42 rue Fontaine reconnaissaient à la petite plaque indiquant « 1713 » apposée sur la porte qu’ils étaient arrivés à destination : 17 et 13 comme A et B, ses initiales qui lui étaient apparues dans la ressemblance graphique de cette date choisie entre toutes. Quelque chose du goût pour un certain mystère annonçait déjà, au seuil de l’atelier qu’il occupa durant presque quarante ans, un peu du voyage que s’apprêtait à faire le visiteur dans ce lieu hors du temps, pourtant situé au cœur la vie nocturne, au bas de la butte Montmartre.
Aux premiers jours de son mariage avec Simone Kahn en 1922 jusqu’à sa disparition en septembre 1966, le fondateur du mouvement surréaliste vécut dans cet atelier, ne descendant que d’un étage en 1949 pour trouver un espace doté d’une pièce en plus, qui lui permettrait d’accueillir sa fille Aube, alors âgée de 14 ans.
Aux premiers jours de son mariage avec Simone Kahn en 1922 jusqu’à sa disparition en septembre 1966, le fondateur du mouvement surréaliste vécut dans cet atelier, ne descendant que d’un étage en 1949 pour trouver un espace doté d’une pièce en plus, qui lui permettrait d’accueillir sa fille Aube, alors âgée de 14 ans. Les années d’exil à New York entre 1938 et 1945 constituèrent la seule interruption de cette vie vécue dans un lieu unique. Point de repère de l’écriture et boussole mentale de l’écrivain, l’atelier fut aussi le quartier général des premières déclarations collectives du groupe surréaliste.
L’appartement et ses deux pièces principales abritaient plus d’œuvres et d’objets qu’il semblait possible d’en contenir. Pour saisir un peu du collectionnisme de Breton et sa quête obsessive de l’objet, il faut remonter à cette histoire fondatrice : en 1917, André Breton acquiert la première pièce de sa collection grâce à l’argent du baccalauréat, une figure moai kavakava de l’île de Pâques. C’est là le début d’une collection qui ne s’achèvera qu’avec sa disparition. L’omniprésence des objets dont s’entoura le fondateur du surréalisme, témoigne de la singularité de sa vision et de ce laboratoire mental où se faisaient et défaisaient les accrochages, évacuant toute idée de hiérarchie des artistes surréalistes — parmi eux, Joan Miró ou Alberto Giacometti, mais aussi de grands précurseurs (Victor Hugo ou Alfred Jarry ), des objets océaniens (majoritairement de Papouasie-Nouvelle Guinée, mais aussi de Polynésie avec les îles Marquises), arts amérindiens, des objets précolombiens (principalement du Mexique, Breton s’y étant rendu en 1938), objets d’art populaire ou naturels, qui prirent place dans ce « palais idéal du surréalisme » qui fut aussi son lieu le plus mythique.
En 2003, le Centre Pompidou s’enrichissait d’un fragment de cette exceptionnelle collection. Le mur situé derrière le bureau de l’écrivain, chargé de quelque 255 objets — chefs-d’œuvre ou bien pierres et minéraux quelconques, glanés au fil des promenades le long du Lot — constituait le pan le plus magistral de l’atelier.
En 2003, le Centre Pompidou s’enrichissait d’un fragment de cette exceptionnelle collection. Le mur situé derrière le bureau de l’écrivain, chargé de quelque 255 objets — chefs-d’œuvre ou bien pierres et minéraux quelconques, glanés au fil des promenades le long du Lot — constituait le pan le plus magistral de l’atelier. Vingt ans après son entrée en collection par voie d’une historique dation de la fille du poète, Aube Breton-Elléouët, un ouvrage intitulé Mur Mondes. L’Atelier d’André Breton entreprend l’étude de l’intégralité de ces objets. Le « Mur Breton » retrace l’histoire croisée d’une collection d’objets et de la constitution d’un regard critique sur la modernité.
C’est le 1er janvier 1922 que Breton emménage avec sa première épouse Simone Breton (née Kahn) dans un immeuble situé à proximité de la place Blanche et de sa vie nocturne — si l’on pense notamment aux bien nommés cabarets du Ciel et de l’Enfer, au pied de l’immeuble du poète. L’atelier est constitué de deux pièces principales donnant sur le boulevard de Clichy. L’écrivain Julien Gracq, l’un des visiteurs réguliers des dernières années, a pu rapporter l’impression persistante d’obscurité, malgré la présence de grandes baies vitrées de cet ancien atelier d’artiste. Mais, aurait-il pu en être autrement ? Dès sa première formulation au sein du Manifeste du surréalisme, ce texte fondateur rédigé par Breton en 1924, naît un mouvement qui favorise l’ambiguïté des ombres — bien plus rarement, la lumière insolente du soleil de midi.
L’atelier est constitué de deux pièces principales donnant sur le boulevard de Clichy. L’écrivain Julien Gracq, l’un des visiteurs réguliers des dernières années, a pu rapporter l’impression persistante d’obscurité, malgré la présence de grandes baies vitrées de cet ancien atelier d’artiste.
Point d’orientation du travail de l’écrivain, espace du collectif lorsque les réunions du groupe surréaliste ou les séances des sommeils s’y tiennent dès l’année de l’installation du couple, lieu tout aussi bien du quotidien et de l’intimité, le « premier atelier » (celui d’avant la guerre) était décrit par Simone Breton dans sa correspondance comme une « pièce de bruit et de lumière » qui en comptait une seconde, faite « de silence et d’ombre ». Durant les années 1920, ils bâtissent ensemble les fondations d’une des collections à l’avant-poste du 20e siècle.
Au sortir du tumulte de la présence de Dada à Paris, Breton, en 1921, devient le conseiller artistique du couturier et collectionneur Jacques Doucet. Dès lors, avec des moyens bien différents des siens, le jeune poète suggère des acquisitions maîtresses au couturier. C’est à partir de là, et un peu par procuration, que sont achetées par Doucet quelques-unes des plus remarquables réalisations modernes du 20e siècle, des Demoiselles d’Avignon (1907) de Pablo Picasso en passant par La Charmeuse de serpent (1907) du Douanier Rousseau, ou de la Rotative plaque de verre (1920) de Marcel Duchamp.
Défricheur de l’art et théoricien d’une esthétique du merveilleux adossé à un « modèle intérieur », promoteur de ce qu’il avait appelé en 1928 dans Le Surréalisme et la peinture, un « œil à l’état sauvage », André Breton réunit au cours de sa vie une exceptionnelle collection par son ampleur et la singularité des partis-pris esthétiques. Ces peintures et sculptures surréalistes, ces objets extra-occidentaux, ces naturalia, pour ne rien dire des objets d’art populaire, vont prendre place, au début des années 1930, sur une grande étagère en bois à degrés, conçue par Breton. Scénographiée par le meuble à gradins, la collection prend une configuration spectaculaire. Trois grandes peintures de Francis Picabia, Joan Miró et Jean Degottex viennent couronner la partie haute de ce mur d’objets. Il faut y voir trois moments distincts de l’histoire du surréalisme — soit le moment Dada, le surréalisme des années 1920 et l’abstraction gestuelle des années 1950. Celle que le visiteur du Musée peut observer aujourd’hui est la reconstitution, à l’identique, de la seconde pièce de l’atelier à la mort du poète.
André Breton réunit au cours de sa vie une exceptionnelle collection par son ampleur et la singularité des partis-pris esthétiques.
Il ne faut pas s’y tromper : les objets aujourd’hui figées dans un accrochage qui ne peut plus varier étaient jadis soumis à des déplacements constants dans l’atelier. Les photographies d’époque du « mur » en cours d’élaboration en témoignent, montrant des modifications au gré de nouvelles acquisitions ou des ventes réalisées par Breton. Celle effectuée avec son ami Paul Éluard dispersa leurs collections respectives d’art africain et océanien, alors que l’Exposition coloniale internationale qui se tenait à Paris en 1931, jette une lumière crue sur leur collectionnisme, car la dénonciation sans ambiguïté du colonialisme trouvait là sa limite : inévitablement, la vente de leurs objets profitait aussi de cette actualité.
Ces liens aux entreprises coloniales de la modernité est un sujet urgent et nécessaire aujourd’hui. La publication de l’ouvrage Mur Mondes s’y attèle pour la première fois : si on sait que Breton a inlassablement combattu en faveur de l’émancipation des peuples opprimés et dénoncé le colonialisme, le poète ne renonça jamais à l’acquisition d’objets issus de la colonisation (même si l’absence presque totale du continent africain rendait ce risque moindre s’agissant des colonies françaises). Au contraire, l’objet était en quelque sorte à ses yeux un « rescapé », placé dans le circuit du merveilleux surréaliste, dont le « mur » de l’atelier semble bel et bien la défense et l’illustration. Pour Breton, l’objet est tout puissant dans son potentiel poétique, et cela jusqu’à gommer toute autre dimension.
Si on sait que Breton a inlassablement combattu en faveur de l’émancipation des peuples opprimés et dénoncé le colonialisme, le poète ne renonça jamais à l’acquisition d’objets issus de la colonisation […] Pour lui, l’objet est tout puissant dans son potentiel poétique, et cela jusqu’à gommer toute autre dimension.
Après le retour d’exil nord-américain, les objets de l’atelier allaient devenir en 1946, les véritables hôtes du lieu. Lorsque Breton fait visiter son atelier, ouvrant ses portes à des reportages photographiques toujours plus nombreux à partir des années 1960, le poète décrit cet intérieur singulier : « Au mur des toiles de Chirico, Max Ernst, Picasso, Miró. Un goût marqué aussi pour les œuvres dites “naïves”. […] Une collection d’objets ethnographiques, attestant une prédilection pour l’art océanien et l’art des Indiens d’Amérique […]. Tout un panneau de masques esquimaux faisant face à un panneau de poupées Hopi, recueillies une à une dans les réserves indiennes d’Arizona. Une vitrine d’oiseaux mouches, une autre d’assez grandes dimensions pour que s’y déploient plusieurs paradisiers, l’argus de Nouvelle-Guinée et l’oiseau-lyre ».
Aimer sur le mode de la disjonction ou de l’étincelle : ce pourrait être là une large part du programme esthétique du surréalisme. Celui qui allait animer l’un des mouvements majeurs du 20e siècle était, comme le définit bien sa fille Aube Breton-Elleouët, cette « personnalité définitive » était aussi fidèle s’agissant des objets de son élection qu’intransigeant avec ceux faisant « acte de surréalisme absolu » (la femme étant largement moins concernée par ce type de mot d’ordre).
Au centre du surréalisme se niche l’idée, capitale, que l’objet est révélateur du désir de son possesseur — ce désir étant l’autre nom pour le poète de pratiquement tout son projet esthétique.
Le « Mur Breton »— c’est-à-dire les 255 objets qui le composent — fut un temps sujet de transactions, de circulations géographiques. Au centre du surréalisme se niche l’idée, capitale, que l’objet est révélateur du désir de son possesseur — ce désir étant l’autre nom pour le poète de pratiquement tout son projet esthétique. C’est peut-être là que réside la plus grande ambivalence du projet émancipateur du surréalisme : la liberté de l’un prive celle de l’autre, quoique la modernité défricheuse d’un « ailleurs » ait pu en dire. Le mur de l’atelier d’André Breton en est un témoignage historique extraordinaire, entre exaltation et mélancolie du « tout autre ». ◼
Découvrez le catalogue
Mur Mondes. L'atelier d'André Breton
sous la direction d'Aurélie Verdier

Otros artículos para leer
Programa de eventos
Vue de l'appartement-atelier d'André Breton
© Bibliothèque Kandinsky/Centre Pompidou