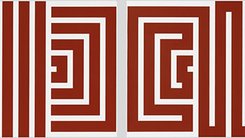Vera Molnár, aux sources du code

Photo © François Molnár, archives Vera Molnár
Courtesy of Galerie Oniris, Rennes
« La chose qui me plaît le plus c'est de voir un crayon courir sur une feuille de papier et le suivre. De temps en temps s'arrêter et gommer. J'adore le crayon car on peut le faire disparaître. Je peux changer d'avis, ce qui n'est pas le cas avec la peinture : lorsqu'elle est sèche, il faut l'aimer et vivre avec. » disait l'artiste. Cette passion de la ligne et du trait n'a jamais quitté Vera Molnár. Jusqu'au dernier moment, elle a continué d'expérimenter et d'explorer le champ des possibles de la droite et des formes géométriques simples, le carré en tête, portée à la fois par une rigueur scientifique et cet irrépressible désir de transgresser les règles, par une obsession de la répétition contredite par la pression du pas de côté indispensable. « L'art est obsessionnel, je ne pense qu'à ça ! » admettait celle qui, en 2022, a produit une série de NFT vendue aux enchères.
Cette radicalité géométrique érigée comme principe et la nécessité du minimalisme comme une évidence s'imposent assez tôt chez la jeune Vera, née Gács à Budapest en 1924 dans une famille aisée, où d'ailleurs elle a appris le français dès ses trois ans grâce à une gouvernante. Elle se souvient de ses premiers pas en art : « J'avais dix ou onze ans et ma famille a décidé que j'étais trop bête et que je ne pourrais pas avoir un bon niveau. Un oncle, qui était peintre du dimanche, m'a offert une boîte de pastels et tous les soirs, je dessinais un coucher de soleil au bord du lac Balaton. C'étaient quatre bandes horizontales colorées : verte pour la prairie qui descendait vers le lac, gris-bleu pour la surface du lac, vert-gris pour les collines de l'autre côté et bleu pour le ciel. Sur la droite, une forme ronde et rouge pour le soleil couchant. » Elle cède à contre-cœur à sa mère qui lui conseille d'ajouter des arbres dans ce paysage pas assez naturaliste à son goût.
J'avais dix ou onze ans et ma famille a décidé que j'étais trop bête et que je ne pourrais pas avoir un bon niveau. Un oncle, qui était peintre du dimanche, m'a offert une boîte de pastels et tous les soirs, je dessinais un coucher de soleil au bord du lac Balaton. C'étaient quatre bandes horizontales colorées.
Vera Molnár
Indépendante d'esprit déjà, Véra s'amuse des moqueries des garçons sur ses cheveux roux, est fascinée par les constellations que forment ses taches de rousseurs sur ses jambes — « Il me semble, aujourd’hui, que c’était ma première leçon d’art non-figuratif » — et par la répartition des points sur les ailes des coccinelles. Elle fait ses premières rencontres artistiques fondatrices par hasard : « À Budapest, il y avait beaucoup d'antiquaires et un jour, à quinze-seize ans, je me suis arrêtée devant une des boutiques et j'ai vu deux choses pour lesquelles je suis tombée raide dingue : un volume sur Dürer où figurait la gravure La Mélancolie et un autre sur Hokusai. Je l'ai acheté avec mon argent de poche parce qu'il y avait beaucoup de variantes du mont Fuji. Je me suis dit que, quand je serai grande, je maîtriserai l'art de la gravure comme Dürer et je ferai des montagnes comme Hokusai ! » Elle s'y tient et rentre à l'école des Beaux-Arts de Budapest en 1942 pour étudier l'histoire de l'art, la peinture et l'esthétique. Elle y fait la connaissance de Judith Reigl, Marta Pan, Simon Hantaï et surtout, de François Molnár. « C'est étonnant d'être face à des choses inattendues. Gosse de riche, j'ai épousé un type plus que pauvre. Il n'y avait pas un seul livre chez lui, mais que des mauvais chromos représentant la Vierge à l'enfant ! ».
L'enseignement perpétré à l'école des Beaux-Arts est, si ce n'est rétrograde, tout au moins très classique et les avant-gardes n'ont pas franchi les frontières du pays dirigé par l'autoritaire Miklós Horthy. C'est seulement après la guerre qu'un nouveau souffle bouscule cette jeune génération qui vient s'abreuver à la librairie-galerie d’Imre Pan : « Je voyais pour la première fois des Hélion abstraits, Braque, Klee, Herbin, Gris… », dit-elle en entretien à Jean-Pierre Arnaud (février 2002). Il s'agit d'un véritable électrochoc qui l'amène à choisir son sujet de mémoire de fin d'année : Cézanne et le cubisme. « C'est à partir de la rencontre du cubisme que ma pratique est passée d'une occupation de jeune fille bien élevée à une passion. » racontait l'artiste à Amely Deiss et Vincent Baby, en 2012 (à l'occasion d'une rétrospective à Rouen).
Diplômés en 1947, François et Vera partent six mois à Rome grâce à une bourse d'étude, mais c'est Paris qui compte. Ils y sont accueillis par un oncle de Vera qui les introduit dans le cercle des artistes hongrois qui se donnent rendez-vous au café Select, dans le quartier de Montparnasse. À partir de là, ils se rapprocheront de nombreux artistes, tels que Michel Seuphor, Félix del Marle, Georges Vantongerloo, Constantin Brancusi, Auguste Herbin, Étienne Hadju ou encore Sonia Delaunay qui encourage Vera. En 1948, elle se marie avec François et l'année d'après, choquée par le procès expéditif et l'exécution du premier ministre hongrois László Rajk, elle décide de ne plus revenir dans son pays natal (il faudra attendre 1976 et sa première exposition à Budapest, ndlr). Sa quête artistique se poursuit dans une capitale en pleine effervescence qui voit arriver des artistes de toute l'Europe, mais aussi d'Amérique latine et d'Asie. Elle rejette l'École de Paris et trace sa voie dans les sillons de l'Art concret, de l’abstraction géométrique et du constructivisme, conjugant mathématiques et géométrie pour créer un art universel conçu par l'esprit avant tout et dénué de toute référence au réel. Vera ne peut cependant pas être enfermée par une approche dogmatique et si elle va rencontrer Max Bill à Zurich en 1957 avec celui qui deviendra un ami cher et qui partage les mêmes préoccupations artistiques, François Morellet, elle reste maître du jeu et chérit son indépendance.
Dès 1959, comme une préfiguration de la suite, elle crée sa « machine imaginaire », soit un programme simple qui impulse une transformation des formes, combinant consignes et interdits. Elle décide des formes, des couleurs, des textures, des matériaux, des supports et dessine sur un rouleau les propositions qu'elle retient. La reconnaissance arrive vite et le couple est invité à participer en 1960 à l'exposition « Konkrete Kunst: 50 Jahre Entwicklung » (« Art contret : 50 ans de développement »), organisée par Max Bill et Margrit Staber à Zurich. En juillet de la même année, ils co-fondent le Centre de recherche d'art visuel (CRAV) avec, entre autres, Garciá Rossi, Julio Le Parc, François Morellet, Yvaral. L'aventure sera brève car rapidement, un conflit insoluble éclate. D'un côté François veut privilégier l'approche scientifique tandis que la majorité est plus intéressée à courir « après les critiques d'art et les galeries ». Lorsque François quitte le groupe — qui deviendra le GRAV (Groupe de recherche d’art visuel) en 1961 — , suivi de près par Vera, il abandonne en définitive le monde de l'art pour se consacrer pleinement à la recherche au CNRS. Dans leur atelier qu'ils intègrent en 1963 au fond d'une cour d'un immeuble du 14e arrondissement parisien, Vera multiplie les algorithmes de sa machine imaginaire, co-fonde en 1967 le groupe Art et Informatique et 1968 sonne telle une déflagration dans son parcours. Pendant que les manifestations étudiantes mobilisent le pays, elle accède « en totale clandestinité » au centre de calcul à Orsay et à de vrais ordinateurs qui lui ouvrent de nouvelles perspectives. « Vous ne pouvez pas imaginer quelle a été l'émotion de voir apparaître pour la première fois sur l'écran ce qui existe naturellement dans votre cerveau ! Il suffit ensuite de taper sur quelques touches pour réaliser le repentir ou faire bouger une forme sur la droite ou sur la gauche. C'était génial ! »
Dans leur atelier qu'ils intègrent en 1963 au fond d'une cour d'un immeuble du 14e arrondissement parisien, Vera multiplie les algorithmes de sa machine imaginaire, co-fonde en 1967 le groupe Art et Informatique et 1968 sonne telle une déflagration dans son parcours. Pendant que les manifestations étudiantes mobilisent le pays, elle acccède « en totale clandestinité » au centre de calcul à Orsay et à de vrais ordinateurs qui lui ouvrent de nouvelles perspectives.
L'ordinateur n'est pas l'objet d'une fascination technique, Vera l'utilise comme un outil lui permettant d'explorer de nouvelles combinaisons possibles, d'aborder de nouveaux calculs pour créer une série et extraire les formes qui répondent à ses critères plastiques. Avec François, l'émulation est toujours d'actualité et ils créent en 1974 le Molnart, un programme qui permet de concevoir des compositions avec un ensemble de carrés dont elle modifie les côtés, et auxquels elle injecte un pourcentage de maladresse pour que son dessin soit plus humain artificiellement. Ce sera une de ses marques de fabrique avec son « 1% de désordre » qu'elle injecte dans ses œuvres, pour brouiller les cartes et déstabiliser le système. Ordre et chaos sont les deux faces d'une même médaille. « Le grand jour de ma vie a été lorsqu'on a eu un ordinateur à la maison. On s'endormait le soir avec le bruit de la table traçante, quelqu'un travaille à ta place, un esclave qui n'est pas syndiqué, qui ne veut pas partir en vacances et qui fait tout ce que je lui demande ! » Grâce à ce nouvel outil, elle fait subir toutes sortes de transformations à la droite, au carré, à la croix, au triangle, aux lettres (M, H, I, V). Elle tire les lignes, les courbes ou des segments mais déchire aussi le papier dans sa série sur la Montagne Sainte-Victoire, une référence à Cézanne. Toutes ses réflexions sont consignées dans ses Journaux intimes depuis 1976, véritable source d'inspiration. En 2022, elle a donné les vingt-deux carnets (1976-2020) au Centre Pompidou, mais tous ayant été scannés, elle y a toujours accès car elle continue de créer encore aujourd'hui alors qu'elle a dû quitter son atelier en 2021 pour un Ehpad.
« Le grand jour de ma vie a été lorsqu'on a eu un ordinateur à la maison. On s'endormait le soir avec le bruit de la table traçante, quelqu'un travaille à ta place, un esclave qui n'est pas syndiqué, qui ne veut pas partir en vacances et qui fait tout ce que je lui demande ! »
Vera Molnár

© Adagp, Paris
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
Passionnée et curieuse, elle le demeure au point de se lancer dans de nouveaux projets, comme ces assiettes avec l'éditeur Bernard Chauveau, une commande pour des vitraux pour l'abbaye de Lérins, mais aussi des cyanotypes, une tapisserie, des sculptures en marbre. C'est seulement après la mort de son mari en 1993 qu'elle a commencé à vendre ses œuvres et est passée aux grands formats dans les années 2000, ce qu'elle poursuit avec des assistants. En 2022, elle a créé son premier NFT, 2% de désordre en coopération et en 2023, la série NFT « Thème et variations », un hommage à Bach et aux Variations Goldberg. Ses œuvres n'ont-elles pas des allures de partitions ? Balayer le titre de ses expositions embrasse la diversité de ses recherches mais aussi son état d'esprit : « Inclinaison – (étude préliminaire à une toile) » (1981), « Ordre et (Dés)ordre » et « Géométrie du plaisir » (1994), « De l'esprit à l'œuvre » (1995), « Tango » (1997), « Une visite guidée à travers mon cerveau », « Extrait de 100 000 milliards de lignes » et « Solo d'un trait noir » (1999), « Car je n'aime pas la couleur verte » (2007)… Entre rigueur et humour, elle a marqué l'histoire de l'art de son sceau — ce qui justifie qu'elle intègre le programme du Bac arts plastiques en 2019 — tout en demeurant fidèle à une règle qu'elle s'est fixée il y a longtemps, « pas une journée sans une ligne ». ◼

© Centre Pompidou / Bibliothèque Kandinsky
Photo © Jean-Christophe Mazur
Plus d'infos sur Vera Molnár sur le site de AWARE https://awarewomenartists.com/artiste/vera-molnar/
Otros artículos para leer
Programa de eventos
Portrait de Vera Molnár, 1961
Photo © François Molnár, archives Vera Molnár
Courtesy of Galerie Oniris, Rennes